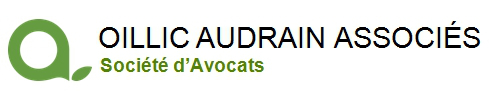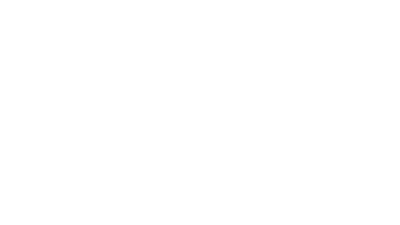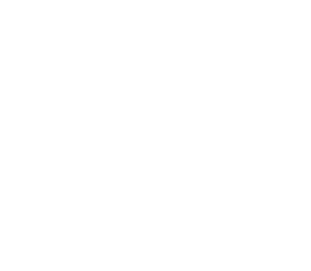A69 : « raison impérative d’intérêt public majeur » vs « utilité publique »
1.
Par un arrêt du 05 mars 2021, le Conseil d’État a considéré que, eu égard à l’intérêt public du projet de liaison autoroutière Castres-Toulouse, les inconvénients qu’il allait générer, notamment en termes de conséquences pour l’environnement, ne présentaient pas un caractère excessif de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique.
Le maître d’ouvrage avait en effet prévu des mesures suffisantes destinées à éviter, réduire ou compenser les incidences de ce projet sur la faune et la flore, mesures qui seraient, en tout état de cause et si nécessaire, précisées ou complétées à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices en matière environnementale.
2.
Le Tribunal administratif de Toulouse a jugé quant à lui le 27 février 2025 que ce projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur.
3.
Un projet définitivement déclaré d’utilité publique mais qui ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur peut donc être mis à l’arrêt.
Comment est-ce possible ?
Tout simplement parce qu’un même projet peut être soumis à deux (ou plusieurs) législations distinctes dont la cohérence n’est pas assurée !
4.
Quelle différence existe-t-il entre une « utilité publique » et une « raison impérative d’intérêt public majeur » ?
Selon le Conseil d’État, une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
La destruction ou la perturbation des espèces protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites.
Le préfet peut toutefois déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives :
- absence de solution alternative satisfaisante ;
- ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
- justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés par la loi et notamment le fait que le projet réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Qu’est-ce qu’une « raison impérative » ? Qu’est-ce qu’un « intérêt public majeur » ?
Ces dispositions ont été introduites sans crier gare (mais « au loup »), par un amendement sénatorial, en soirée, lors du débat parlementaire sur le projet de loi d’orientation agricole (Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006).
Elles n’ont fait l’objet d’aucune étude d’impact, d’aucune discussion, d’aucun éclairage. Apparemment l’objectif poursuivi était de sécuriser juridiquement les prélèvements de loups !
C’est donc au Conseil d’État qu’est revenu le soin de les définir.
Reprenant l’analyse de la CJUE (CJUE, 29 juillet 2019, affaire C-411/17, point 155), le Conseil d’Etat considère que l’intérêt public majeur, de nature à justifier la réalisation d’un projet, doit être d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation (CE, 03 juin 2020, n°425395).
Le contrôle qu’il opère est un contrôle de l’erreur de qualification juridique des faits (CE, 24 juillet 2019, n°414353). Autant dire que l’appréciation est casuistique, qu’un Tribunal administratif pourra considérer que le projet n’est motivé par aucune raison impérative d’intérêt public majeur, qu’une Cour administrative d’appel pourra considérer l’inverse et que le Conseil d’État pourra juger que cette dernière a commis une erreur de qualification juridique des faits.
Ce parcours est tout à fait classique en contentieux administratif.
5.
L’enseignement qui peut être tiré du jugement du Tribunal administratif de Toulouse est que, dès lors qu’un projet est susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat, la déclaration d’utilité publique n’est plus un sauf-conduit.
Cette insécurité juridique est bien regrettable. Elle est coûteuse et démotivante. Pire, elle alimente l’idée d’impuissance de la gouvernance démocratique.